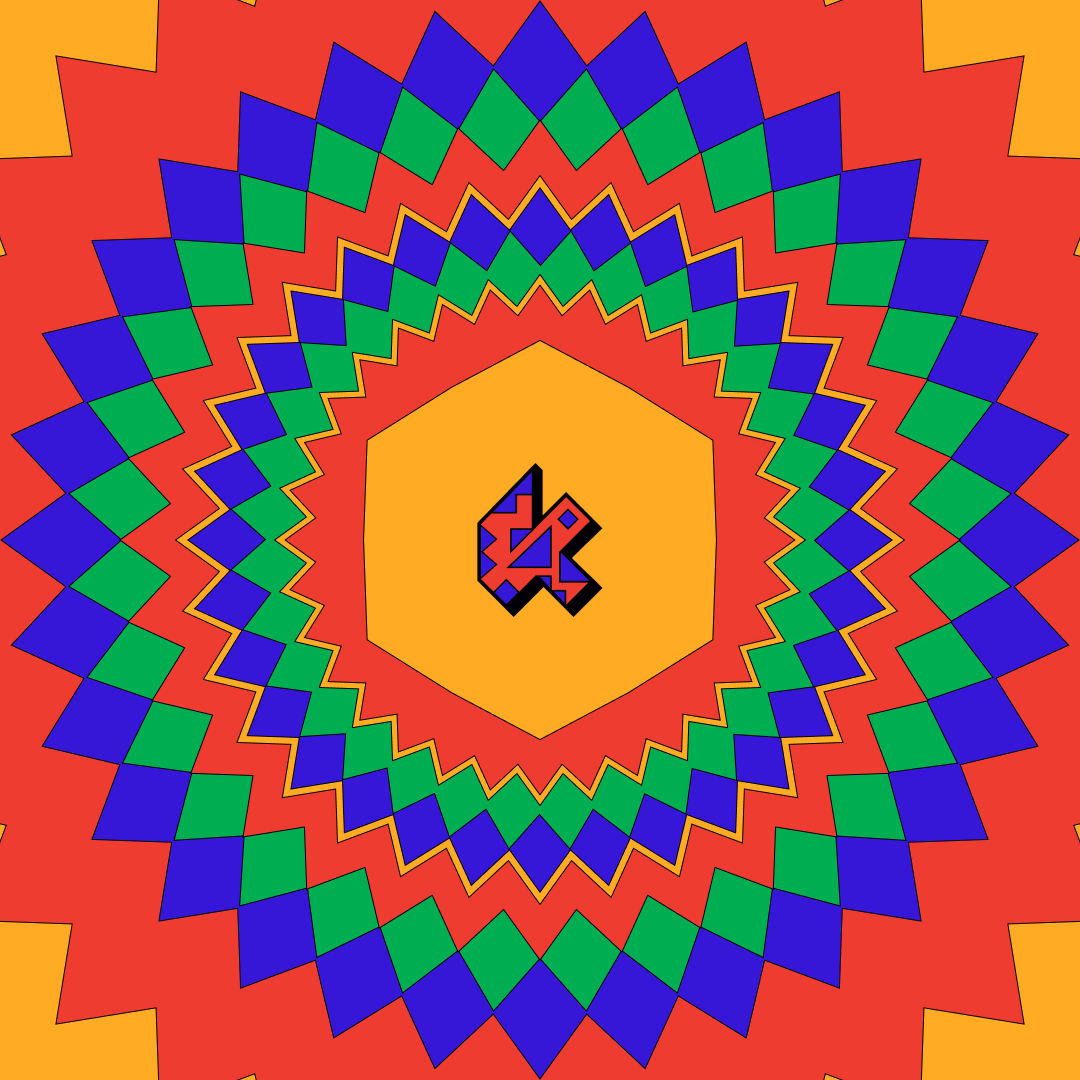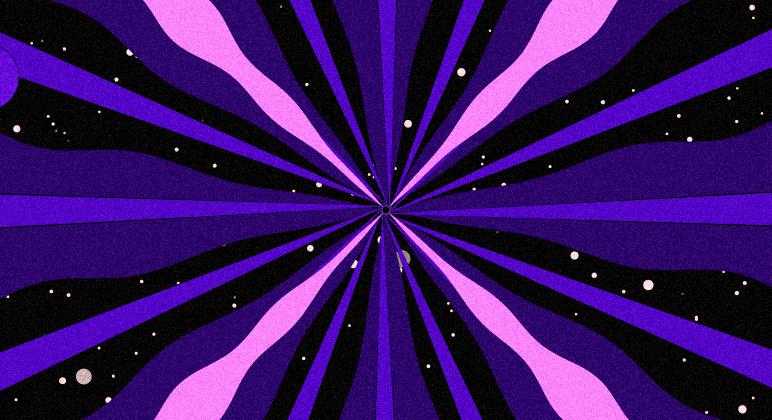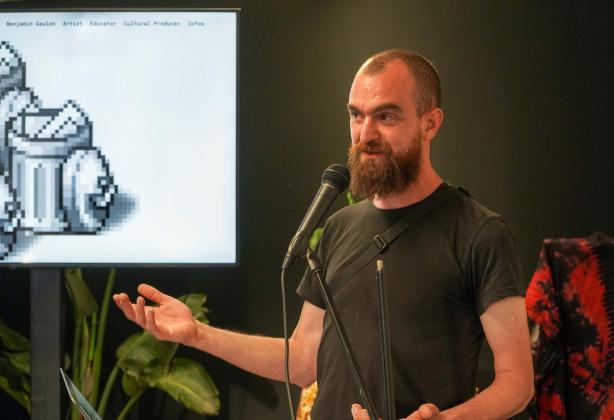Benjamin Gaulon
Benjamin Gaulon est artiste, chercheur, enseignant et producteur culturel basé à Paris. Il a précédemment publié des travaux sous le nom de « Recyclism ». Ses recherches portent sur les limites et les défaillances des technologies de l’information et de la communication : obsolescence programmée, consumérisme et société du jetable, propriété et vie privée, explorés à travers le détournement, le hacking et le recyclage. Ses projets peuvent prendre la forme de logiciels, d’installations, de matériel, de projets web, d’œuvres interactives ou d’interventions dans l’espace public et sont, lorsque cela est possible, open source.
Avec Dasha Ilina, il est membre fondateur du collectif NØ, une organisation à but non lucratif dont la mission est de soutenir et promouvoir la recherche et les pratiques émergentes en art et design qui interrogent l’impact social et environnemental des technologies de l’information et de la communication en France et au-delà, depuis sa création en 2018. Ils codirigent ensemble NØ SCHOOL NEVERS depuis sa première édition en 2019.
Il est actuellement professeur à Sciences Po, à l’École normale supérieure Paris-Saclay pour le diplôme en Recherche-Création (ARRC) et à CentraleSupélec – Université Paris-Saclay. Il a été professeur associé à Parsons Paris, où il a dirigé le programme MFA Design + Technology et le BFA Art, Media and Technology, programme qu’il a développé et lancé en 2013. Avant cela, il a été maître de conférences au National College of Art and Design à Dublin, chercheur associé au CTVR (Centre de recherche en télécommunications du Trinity College) et directeur de DATA (Dublin Art and Technology Association) à Dublin.
Embracing Obsolescence, Glitch, and the Internet of Living Things
Je suis Benjamin Gaulon, également connu sous mon alias de recherche Recyclism. Je suis artiste, chercheur, enseignant et producteur culturel basé à Paris. Mon travail se situe à l’intersection du critical making et de la recherche artistique, explorant les limites et les défaillances des technologies de l’information et de la communication. Je m’intéresse à des thématiques telles que l’obsolescence programmée, le consumérisme, la société du jetable, la propriété et la vie privée, à travers le détournement, le hacking, le recyclage et la subversion créative.
Parallèlement à ma pratique, je suis professeur à Sciences Po et à l’École normale supérieure Paris-Saclay (dans le cadre de leur programme Recherche-Création), ainsi qu’à CentraleSupélec, Université Paris-Saclay. J’ai cofondé NØ, un collectif soutenant la recherche artistique et design émergente interrogeant l’empreinte socio-environnementale des TIC depuis 2018. Depuis 2019, je codirige NØ SCHOOL NEVERS, et depuis 2022, je suis directeur artistique de l’Espace USANII à Nevers.
Projets clés et esprit des ateliers
Au début de ma carrière, j’ai développé des projets sous le nom Recyclism, mêlant art interactif, esthétique glitch, informatique physique et interventions sur les déchets électroniques. Parmi mes travaux notables : de Pong Game, PrintBall, Corrupt, Recycling Entertainment System, 2.4 GHz Project, Hard Drivin’ et ReFunct Media.
Par exemple, PrintBall combinait graffiti, robotique et esthétique jet d’encre—projetant des messages sur les murs à l’aide d’un pistolet à billes de peinture. Avec 2.4 GHz, j’ai intercepté des signaux de surveillance sans fil et de babyphones, plaçant des récepteurs dans l’espace public pour questionner la vie privée, la surveillance et notre conscience de l’omniprésence numérique. Les réactions du public—curiosité, indifférence, surprise—ont servi de catalyseur pour des dialogues au-delà des galeries (We Make Money Not Art).
Depuis 2005, j’anime des ateliers de hacking de matériel et de recyclage électronique en Europe et aux États-Unis, invitant les participants à réinventer les appareils obsolètes comme outils créatifs et génératifs. En 2011, j’ai créé le Recyclism Hacklab, un espace collaboratif pour l’informatique physique, le hacking matériel, l’exploration ouverte et le mentorat.
Glitch, corruption et critical making
Au cœur de ma pratique se trouve l’esthétique glitch—la perturbation intentionnelle ou accidentelle des systèmes technologiques. Des œuvres comme KindleGlitched (ebooks endommagés) et Corrupt.video explorent comment l’échec et la corruption peuvent susciter une réflexion critique sur la fragilité et l’impermanence de la technologie.
Pour moi, le glitch n’est jamais qu’un geste esthétique : c’est une posture critique vis-à-vis de la matérialité et de la dégradation numérique. En matérialisant l’erreur, je cherche à remettre en question les idées reçues sur la fiabilité, la permanence et notre confiance implicite dans les systèmes omniprésents. Le glitch devient à la fois méthode et métaphore, un moyen de reprendre le contrôle face à l’obsolescence.
Vers l’Internet des choses vivantes
Mes recherches récentes prolongent ces thématiques dans les écologies technologiques rurales, ou ce que l’on pourrait appeler l’Internet des choses vivantes—une enquête à la fois poétique et analytique sur la manière dont électricité, données et organismes vivants cohabitent dans des circuits partagés.
Je m’interroge : comment la technologie interagit-elle avec des agents non humains—plantes, écosystèmes, communautés rurales—pour générer de nouvelles formes d’incarnation, d’affect et de connectivité ? Que se passe-t-il lorsque le courant électrique traverse les racines et les feuilles ? Quand les réseaux de capteurs captent l’état végétal ? Quand le « glitch » n’est plus seulement un bruit visuel, mais une interférence affective entre humain, plante et signal ?
Ces recherches s’appuient sur l’archéologie des médias, l’anthropologie technologique et le design écologique spéculatif—mais restent ancrées dans la méthodologie de critical making que j’ai développée : hacking, réemploi, déconstruction, revitalisation. Les composants obsolescents deviennent des conduits vivants ; les lieux ruraux se transforment en laboratoires expérimentaux ; le glitch devient un pont entre le numérique et l’organique.
Critical making : méthode et impact
Mon art-recherche repose sur ce que j’appelle le critical making, où le hacking pratique et les interventions DIY rencontrent théorie, critique et pédagogie.
-
Je réutilise de vieux appareils électroniques pour créer de nouvelles formes, invitant à réfléchir sur l’obsolescence programmée et le consumérisme.
-
J’emploie glitch et dysfonctionnement pour révéler la matérialité numérique et questionner notre attachement émotionnel aux interfaces lisses.
-
J’anime des ateliers et actions publiques pour transformer le public en co-enquêteurs, développant des compétences en hacking, données, énergie et écologie.
-
Je conçois les paysages ruraux non comme techno-arriérés, mais comme des terrains critiques pour repenser nos relations à l’énergie, au réseau et à l’environnement.
Vers KIKK : questions et horizons
Au KIKK, j’aimerais tisser un récit reliant obsolescence programmée, glitch matériel et affect techno-rural, en posant des questions telles que :
-
Comment l’échec technologique révèle-t-il sa dimension politique ?
-
Quelle forme d’agence matérielle émerge lorsque les courants électriques croisent la vie organique ?
-
Peut-on imaginer des glitches écologiques—interférences électrophysiologiques—comme des formes de critique vivante ?
-
Comment les makers ruraux peuvent-ils transformer les appareils obsolescents en outils d’innovation locale, de résilience et d’intimité ?
À travers documentation visuelle, prototypes, anecdotes d’ateliers et vignettes spéculatives, cette intervention retracera l’arc du glitch à la clairière : des pixels corrompus à la technicité vécue en cohabitation avec la nature.
Glitch comme poétique biotech
En résumé, mon parcours sous le nom Recyclism consiste à accueillir l’échec—non pas comme défaite, mais comme seuil créatif. L’obsolescence programmée devient ouverture ; le glitch devient lentille ; l’électricité rurale devient poésie.
À travers le critical making, nous pouvons réemployer les débris technologiques de notre monde—où la panne n’est pas synonyme de rupture, mais invite à l’émergence, à l’entrelacement et à de nouveaux récits du care.